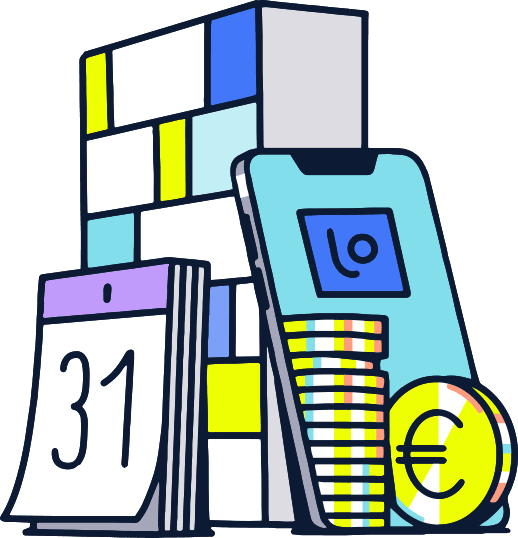Dans un marché où chaque dixième de point compte, les frais d’assurance-vie sont devenus le nouveau nerf de la performance.
Longtemps dissimulés dans les petites lignes, ils reviennent aujourd’hui au centre du débat, car ils peuvent, à eux seuls, effacer plusieurs années de rendement.
L’émergence de contrats digitaux à frais ultra-compétitifs a rebattu les cartes : là où les offres traditionnelles facturent encore près de 1 % de frais de gestion sur unités de compte, les acteurs les plus agiles descendent désormais sous la barre des 0,4 %.
Et cette différence, apparemment minime, peut atteindre plusieurs milliers d’euros de gain sur la durée d’un contrat.
Dans un contexte où les épargnants recherchent à la fois transparence, flexibilité et performance nette, comprendre le fonctionnement de l’assurance-vie et la mécanique des frais — et savoir comment les maîtriser — n’est plus une option : c’est un réflexe d’investisseur averti.
Les essentiels à retenir :
- La maîtrise des frais est aujourd’hui l’un des leviers les plus puissants pour améliorer durablement la performance nette, à condition de l’associer à des supports de qualité et à une vraie diversification de son contrat d’assurance-vie.
- Louve Infinity affiche des frais de gestion de supports en unités de compte à 0,35 % pour son lancement (0,39 % à terme) — des frais ultra bas sur le marché.
- 0 % de frais d’entrée, de versement, de dossier, de sortie et d’arbitrage : une structure tarifaire totalement transparente, sans frais cachés.
- Les frais internes des supports financiers (ETF, fonds, SCPI) s’ajoutent à ceux du contrat, mais restent maîtrisés grâce à une sélection de supports à faibles coûts.
- Une différence de 0,15 % de frais par an sur 20 ans représente plus de 3 500 € d’écart de performance pour un investissement de 50 000 €.
- Selon une simulation réalisée par Les Échos Études portant sur 22 contrats du marché, Louve Infinity est le premier contrat à afficher des frais de gestion sur unités de compte à 0,39 %, soit le niveau le plus bas du panel.
L’assurance-vie est un placement souple et performant, mais sa rentabilité dépend directement des frais prélevés par l’assureur.
Ces frais varient d’un contrat à l’autre et peuvent réduire significativement le rendement net de votre épargne, le taux de votre assurance-vie.
Pour bien comprendre leur impact, il est essentiel de distinguer les principaux types de frais pratiqués sur le marché.
Frais d’entrée (ou frais sur versement)
Les frais d’entrée – parfois appelés frais de versement – sont prélevés à chaque dépôt sur votre contrat, qu’il s’agisse du versement initial ou de versements complémentaires.
Ils sont exprimés en pourcentage du montant versé et peuvent atteindre jusqu’à 5 % dans les contrats distribués par les réseaux bancaires traditionnels.
Un mauvais départ en quelque sorte, car pour un versement de 10 000 € avec 3 % de frais d’entrée, seuls 9 700 € sont réellement investis.
Ces frais rémunèrent principalement le réseau de distribution (banque, courtier, conseiller). Les contrats en ligne se distinguent en les supprimant totalement.
Il ressort de l'analyse Les Échos Études que les frais de versement appliqués sur le marché peuvent atteindre 5 % dans plusieurs contrats traditionnels, alors que la moyenne des frais minimums observés est de 1,21 %.
Louve Infinity se distingue en appliquant 0 %, ce qui maximise la part réellement investie par l’épargnant.
Investir en assurance-vie comporte des risques et doit s’envisager sur le long terme. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les objectifs de rendement sont non garantis.
Frais de dossier
Les frais de dossier sont des frais fixes, indépendants du montant investi.
Ils couvrent les coûts administratifs liés à l’ouverture du contrat, à la création du compte et au traitement des documents légaux.
Ils sont aujourd’hui de plus en plus rares, notamment sur les contrats 100 % digitaux.
Certaines compagnies facturent encore entre 10 € et 50 €, mais la plupart des nouveaux acteurs les ont supprimés.
Chez Louve Infinity : aucun frais de dossier.
Frais de gestion
Les frais de gestion sont prélevés chaque année sur l’épargne gérée et diffèrent selon le support choisi :
Les frais de gestion sur unités de compte ont un impact majeur sur la performance à long terme, car ils s’appliquent chaque année à la totalité du capital investi (et pas seulement aux gains).
Ils feront l’objet d’un chapitre complet plus loin dans cet article.
À la lumière de l’étude Les Échos Études portant sur 22 contrats, les frais annuels de gestion sur unités de compte observés sur le marché oscillent majoritairement entre 0,80 % et 1 %, avec une moyenne des frais minimums de 0,67 %.Avec 0,35 % en période de lancement, puis 0,39 %, Louve Infinity se situe dans la catégorie la plus compétitive du marché.
Les Échos Études indiquent également que les frais minimums de gestion du fonds en euros se situent autour de 0,83 % en moyenne.Louve Infinity, avec 0,60 %, se positionne en dessous de ce niveau.
Frais d’arbitrage
Les frais d’arbitrage sont prélevés lorsque vous modifiez la répartition de votre épargne, par exemple en transférant des sommes d’un support vers un autre.
Ils peuvent être exprimés en pourcentage du montant transféré (souvent entre 0,5 % et 1 %) ou sous forme d’un forfait fixe (de 10 à 30 € par opération).
De nombreux contrats modernes, comme Louve Infinity, ne facturent plus ces arbitrages, permettant une gestion plus souple et réactive.
Selon les données comparatives des Échos Études, si plusieurs contrats affichent un tarif de 0 % sur les arbitrages, beaucoup appliquent en pratique des frais selon les supports concernés (ETF, actions ou immobilier). Louve Infinity fait partie des contrats dont les arbitrages sont réellement gratuits, quel que soit le support concerné.
Frais sur options de gestion
Certains contrats proposent des options automatiques de gestion, telles que :
- le rééquilibrage périodique (maintenir la répartition cible entre fonds euros et unités de compte),
- la sécurisation des plus-values (transfert automatique des gains vers le fonds en euros),
- l’investissement progressif (versements étalés dans le temps pour lisser le risque d’entrée),
- ou la gestion profilée, parfois appelée gestion pilotée (allocation prédéfinie selon un niveau de risque).
Selon l’étude Les Échos Études, ces services peuvent être facturés en supplément, souvent entre 0,10 % et 0,30 % par an.
Ils simplifient la gestion pour les épargnants qui ne souhaitent pas suivre eux-mêmes les marchés, mais il est essentiel de vérifier leur coût et leur adéquation à votre profil d’investisseur.
Chez Louve Infinity, l’approche repose aujourd’hui sur une gestion libre, à frais réduits, offrant à chaque investisseur la possibilité de construire et d’ajuster son allocation en toute autonomie.
À terme, des modes de gestion profilée ou sous mandat pourraient venir compléter cette offre, pour accompagner les épargnants qui préfèrent déléguer la gestion de leur contrat, tout en conservant les principes de transparence et de compétitivité tarifaire propres à Louve Infinity.
Astuce : avant de souscrire, consultez toujours les conditions générales pour savoir si certaines options de gestion sont activées par défaut et vérifier si elles correspondent à votre stratégie patrimoniale.
Frais de garantie (optionnels)
Certains contrats d’assurance-vie incluent des garanties complémentaires, comme :
- la garantie plancher décès,
- la garantie cliquet,
- ou la garantie plancher majorée.
Elles permettent de protéger le capital transmis en cas de décès, même en cas de baisse des marchés.
Ces garanties sont facultatives, mais leurs coûts peuvent représenter jusqu’à 0,50 % par an supplémentaire sur les encours couverts.
Elles doivent donc être évaluées selon votre profil et vos besoins réels.
Frais de sortie ou de rachat
Certains contrats d’assurance-vie appliquent des frais au moment d’un retrait, qu’il s’agisse d’un rachat partiel (retrait d’une partie de l’épargne) ou d’un rachat total (clôture complète du contrat).
Ces frais sont généralement dégressifs dans le temps : ils peuvent atteindre 3 % la première année, puis diminuer progressivement jusqu’à 0 % après 8 ans.
Ils visent à compenser les coûts de mise en place et de gestion du contrat lorsque celui-ci est clos prématurément.
Dans le cas d’une sortie en rente viagère – c’est-à-dire la conversion du capital en un revenu régulier à vie – les frais de sortie sont en principe intégrés dans le calcul de la rente.
Autrement dit, ils ne se traduisent pas par un prélèvement explicite, mais peuvent affecter légèrement le montant de la rente versée, selon les conditions de l’assureur et les frais de gestion appliqués à la phase de rente.
Les contrats les plus récents et les plateformes 100 % en ligne ont supprimé ces frais pour offrir une liquidité totale dès la première année.
L’épargnant peut ainsi effectuer des retraits librement, sans pénalité, tout en conservant les avantages fiscaux de l’assurance-vie.
D’après le panel analysé par Les Échos Études, Louve Infinity applique une politique de 0 % de frais de rachat, sans conditions particulières.
Tableau récapitulatif des frais moyens observés sur le marché
Il ressort de l’étude Les Échos Études que les frais minimums constatés sur le marché (tous types confondus) s’établissent en moyenne à :
- 1,21 % de frais de versement,
- 0,83 % de frais de gestion fonds euros,
- 0,67 % de frais de gestion UC,
- 0,21 % de frais d’arbitrage.
Louve Infinity se place systématiquement sous ces moyennes, avec 0 % de frais d’entrée, 0,60 % sur fonds euros, 0,35–0,39 % sur UC, et 0 € d’arbitrage.
Les unités de compte (UC) sont la composante la plus dynamique d’un contrat d’assurance-vie.
Elles permettent d’investir sur les marchés financiers (actions, obligations, SCPI, ETF, fonds thématiques, etc.) et d’espérer un rendement supérieur à celui du fonds en euros.
Mais leur performance nette dépend fortement du niveau de frais de gestion appliqué, un sujet souvent source de confusion.
Des frais de gestion plus élevés… mais souvent mal compris
Contrairement au fonds en euros, dont le capital est garanti, les unités de compte comportent un risque de perte en capital.
En contrepartie, elles offrent un potentiel de performance supérieur, à condition de bien comprendre la structure réelle des frais.
Sur le marché, les frais dits “de gestion sur UC” varient entre 0,80 % et 1 %.
Mais cette appellation est souvent trompeuse, car elle ne recouvre qu’une partie des coûts réels.
Attention aux abus de langage sur les “frais de gestion UC”
De nombreux assureurs parlent de frais de gestion sur unités de compte, mais il s’agit en réalité de frais de gestion du contrat appliqués aux supports UC.
À cela s’ajoutent les frais internes propres à chaque support, facturés par la société de gestion du fonds (ETF, OPCVM, fonds thématique, immobilier, etc.).
Autrement dit, les frais totaux sur vos unités de compte sont la somme de :
Chez Louve Infinity, les frais de gestion des supports UC s’élèvent à 0,35 % (en période de lancement), soit deux à trois fois moins que la moyenne du marché.
Les supports proposés (notamment les ETF) présentent quant à eux des frais internes très faibles, sans frais de surperformance.
Ce double levier – frais de contrat bas et supports peu chargés – permet de maximiser la performance nette de votre épargne sur le long terme.
L’impact des frais sur le rendement : un effet cumulatif majeur
Les frais de gestion peuvent sembler faibles à première vue, mais leur effet cumulé sur la durée est considérable.
Chaque année, ils sont prélevés sur l’ensemble du capital, ce qui réduit mécaniquement la croissance de votre épargne.
Même une différence de 0,1 % ou 0,15 % par an a un impact mesurable sur le long terme, en raison des effets de la capitalisation.
Prenons un exemple concret sur un contrat d’assurance-vie investi à 5 % brut par an pendant 20 ans, avec un capital initial de 50 000 € :
Un écart de 0,15 % par an se traduit par plus de 3 500 € de différence après 20 ans.
Même une différence plus fine de 0,11 % (entre 0,50 % et 0,39 %) génère encore plus de 2 500 € de gain sur la même période.
D’après la simulation menée par Les Échos Études, les écarts de frais sur 8 ans peuvent aller du simple au quadruple entre les contrats du marché. Louve Infinity ressort comme le contrat le moins coûteux du panel, avec 4 469 € de frais cumulés dans le scénario testé, soit plusieurs milliers d’euros de moins que la plupart des autres offres.
Louve Infinity : une tarification avantageuse dès le lancement
Louve Infinity affiche actuellement 0,35 % de frais de gestion sur supports UC dans le cadre de son lancement, positionnant le contrat parmi les plus compétitifs du marché.
À terme, le niveau standard sera fixé à 0,39 %, un taux qui reste largement inférieur à la moyenne des contrats d’assurance-vie, souvent comprise entre 0,8 % et 1 %.
Cette structure de frais traduit la philosophie du contrat :
- Transparence totale sur les coûts,
- Aucune option imposée,
- Et une sélection de supports à faibles frais internes, notamment des ETF, sans frais de surperformance.
Résultat : même à 0,39 %, Louve Infinity reste deux fois moins cher que la plupart des contrats traditionnels, tout en conservant un niveau de service et d’accompagnement humain.
Investir en assurance-vie comporte des risques et doit s’envisager sur le long terme. Les assurances-vie sont des contrats composés de fonds euros et d’unités de compte (UC) et chaque UC a ses propres frais en plus des frais du contrat. Les montants investis sur les supports en unités de compte supportent des risques de perte en capital. Ils ne sont pas garantis par l'assureur et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les objectifs de rendement sont non garantis.
Les écarts de frais entre contrats d’assurance-vie se sont accentués ces dernières années, avec l’émergence des plateformes digitales et des courtiers en ligne.
Selon le comparateur de l’UFC Que Choisir, qui recense plus de 180 contrats représentant 80 % du marché, les différences de tarification peuvent multiplier par trois les frais de gestion d’un contrat à l’autre.
Contrats bancaires traditionnels : les plus chers du marché
Les contrats distribués par les banques de détail restent les plus onéreux.
Ils cumulent généralement :
- des frais d’entrée entre 2 % et 5 %,
- des frais de gestion sur unités de compte souvent supérieurs à 1 %,
- et parfois des frais d’arbitrage facturés à chaque mouvement.
Ces niveaux s’expliquent par un modèle de distribution reposant sur un réseau d’agences et de conseillers rémunérés en partie par les frais prélevés.
Résultat : une partie significative du rendement potentiel de l’épargnant est absorbée par ces coûts fixes et récurrents.
Assureurs historiques : une lente adaptation
Les compagnies d’assurance traditionnelles (Axa, Generali, Aviva, etc.) ont réduit leurs frais sur certains contrats récents, mais la moyenne reste élevée.
Les contrats les plus anciens affichent encore des frais de gestion proches de 0,9 % à 1 % sur les UC, avec peu de transparence sur les frais internes des supports.
Les nouveaux produits de ces acteurs sont souvent mieux positionnés (autour de 0,6 % à 0,7 %), mais restent au-dessus des contrats en ligne à cause de leur structure de coûts et du maintien d’un accompagnement humain systématique.
Plateformes digitales et fintechs : la nouvelle norme à bas frais
Les plateformes digitales ont bouleversé le marché de l’assurance-vie avec des offres sans frais d’entrée et à faibles frais de gestion, souvent entre 0,4 % et 0,6 % sur les unités de compte.
Elles s’appuient sur :
- une distribution 100 % en ligne,
- une architecture ouverte de supports financiers (ETF, fonds indiciels, SCPI, private equity),
- et une transparence totale sur les frais.
Les Échos Études montrent que les contrats digitaux offrent généralement entre 0,40 % et 0,60 % de frais de gestion sur UC. Avec 0,35 % en période de lancement puis 0,39 % à terme, Louve Infinity se positionne au-delà du standard de compétitivité, dans le segment le plus bas observé.
Comparatif synthétique des frais moyens constatés en 2025
Selon l'analyse Les Échos Études portant sur 22 contrats, c'est précisément sur les postes de frais les plus déterminants — frais d’entrée, frais d’arbitrage et frais de gestion UC — que les écarts de marché sont les plus marqués. Louve Infinity se situe systématiquement au niveau le plus bas de chacun de ces postes, renforçant sa compétitivité structurelle.
Lecture du marché : vers la normalisation des frais bas
Les épargnants sont de plus en plus attentifs aux frais totaux, et cette tendance structurelle pousse tout le secteur à plus de transparence et de compétitivité.
Le modèle à faibles frais s’impose progressivement comme la norme, tandis que les acteurs traditionnels sont contraints de réviser leurs grilles tarifaires pour rester attractifs.
En 2025, choisir une assurance-vie performante ne repose plus seulement sur le rendement du fonds en euros ou la diversité des supports proposés, mais sur un équilibre entre structure de frais et qualité d’allocation.
Un contrat à frais réduits est un atout, mais il ne garantit pas la performance s’il est investi dans des supports peu performants ou mal diversifiés.
À long terme, la performance réelle d’un contrat dépend donc à la fois :
- de la maîtrise des frais (pour ne pas rogner la capitalisation),
- et de la qualité des supports choisis (ETF, fonds indiciels, immobilier, etc.),
qui doivent être cohérents avec le profil de risque et les objectifs d’investissement de l’épargnant.
C’est précisément cette combinaison — frais maîtrisés + sélection rigoureuse de supports performants — qui constitue la philosophie de Louve Infinity.
Les écarts de frais entre contrats d’assurance-vie ne sont pas dus au hasard.
Ils reflètent des modèles économiques différents, des stratégies de distribution distinctes et, parfois, des niveaux de service ou de sélection de supports inégaux.
Comprendre ces différences permet d’identifier ce qui justifie réellement les frais d’un contrat — et ce qui ne les justifie pas.
Le modèle de distribution : réseau physique Vs plateforme digitale
Les contrats distribués par les banques ou les assureurs traditionnels s’appuient sur des réseaux d’agences et des conseillers rémunérés en partie par les frais.
Chaque intermédiaire (banquier, courtier, assureur) perçoit une part de ces commissions, ce qui alourdit mécaniquement le coût final pour l’épargnant.
À l’inverse, les plateformes digitales comme Louve Invest fonctionnent sans intermédiaires physiques :
les souscriptions, le suivi et la gestion s’effectuent intégralement en ligne.
Ce modèle allégé permet de réduire drastiquement les coûts de distribution, et donc de proposer des frais de gestion plus compétitifs, sans rogner sur la transparence ni sur la qualité du conseil.
Les rétrocessions et marges de gestion
Une partie des frais de gestion prélevés sur les supports financiers d’une assurance-vie (les unités de compte) peut donner lieu à des commissions de distribution versées par les sociétés de gestion aux assureurs ou distributeurs du contrat.
Ces rémunérations, appelées rétrocessions (ou inducements dans la réglementation européenne), constituent un mode de partage des frais entre les différents acteurs de la chaîne de distribution.
Ce mécanisme est strictement encadré par deux grandes directives européennes :
- la directive (UE) 2014/65 — MiFID II, art. 24 §9 (Markets in Financial Instruments Directive), entrée en vigueur le 3 janvier 2018,
- et la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurance (DDA), transposée en droit français par l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018.
Depuis leur mise en application, les distributeurs sont tenus :
- d’informer clairement leurs clients de l’existence, de la nature et du montant des éventuelles rétrocessions perçues ;
- et de démontrer que la perception de ces rémunérations améliore la qualité du service rendu au client, sans créer de conflit d'intérêt ni nuire à son intérêt.
Ces commissions ne sont donc pas interdites, mais doivent être transmises en toute transparence et justifiées par un service réel apporté à l’épargnant.
Elles restent aujourd’hui couramment utilisées en France, notamment au sein des réseaux bancaires, des compagnies d’assurance traditionnelles et de certains courtiers, dans le cadre de modèles de distribution intégrant un accompagnement humain et personnalisé.
En parallèle, d’autres acteurs ont choisi de mettre en place des modèles sans rétrocessions ou avec rémunération forfaitaire directe, afin de simplifier la lecture des frais et de faciliter la comparaison entre supports pour les investisseurs.
La qualité et le coût des supports financiers
Les frais peuvent aussi varier selon les supports proposés :
- Les fonds actifs et produits structurés sont souvent plus chers (jusqu’à 2 % de frais internes).
- Les ETF et fonds indiciels, eux, affichent des coûts beaucoup plus faibles (souvent entre 0,05 % et 0,30 %).
Certains contrats cumulent un niveau de frais de gestion élevé et des supports coûteux, ce qui pèse lourdement sur le rendement final.
À l’inverse, Louve Infinity privilégie des supports performants et transparents, notamment des ETF, pour offrir un rapport rendement/frais optimal.
Le niveau de service et la personnalisation
Les frais peuvent également refléter le niveau d’accompagnement proposé.
Un contrat piloté par un conseiller attitré, incluant un suivi patrimonial ou une allocation sur mesure, entraîne souvent des frais supplémentaires.
À l’opposé, les plateformes digitales offrent une autonomie totale, avec des outils de suivi et de simulation en ligne, tout en laissant la possibilité d’un accompagnement humain à la demande.
Louve Infinity s’inscrit dans une approche hybride et transparente :
- autonomie totale pour les épargnants qui souhaitent gérer leur contrat eux-mêmes,
- et accompagnement personnalisé pour ceux qui préfèrent être guidés dans leurs choix d’investissement.
La différence tient dans le modèle : chez Louve Infinity, le conseil est inclus, sans frais additionnels ni rétrocessions cachées.
Autrement dit, les épargnants bénéficient d’un accompagnement de qualité et d’une tarification claire, où chaque euro de frais est directement lié à la performance et à la gestion du contrat, pas à la distribution de produits.
Ce modèle vise à concilier simplicité, transparence et accessibilité, pour permettre à chacun d’investir en confiance — qu’il soit totalement autonome ou accompagné.
En résumé : ce qui explique les écarts de frais
Les écarts de frais s’expliquent donc moins par la nature de l’assurance-vie elle-même que par le modèle économique et la philosophie de gestion du distributeur.Les contrats modernes — digitaux, transparents et orientés performance nette — redéfinissent aujourd’hui les standards du marché.
Sur un marché de l’assurance-vie où les frais varient du simple au triple selon les contrats, Louve Infinity a été conçu autour d’un objectif simple : offrir une assurance-vie claire, performante et à frais réduits, sans compromis sur la qualité des supports proposés.
Une tarification lisible et compétitive
Louve Infinity affiche aujourd’hui 0,35 % de frais de gestion sur supports en unités de compte (UC), dans le cadre de son lancement.
À terme, le niveau standard sera fixé à 0,39 %, un taux qui demeure nettement inférieur à la moyenne du marché, généralement comprise entre 0,8 % et 1 %.
Cette tarification unique comprend tous les frais de gestion du contrat :
- aucun frais d’entrée ou de versement,
- aucun frais de dossier,
- aucun frais d’arbitrage,
- et aucune option imposée (garanties ou gestion pilotée).
Les frais de garantie restent entièrement optionnels, pour ne facturer que les services réellement utilisés.
L’objectif est simple : que les investisseurs comprennent précisément où vont leurs frais, et qu’ils bénéficient d’une performance nette maximale.
Investir en assurance-vie comporte des risques et doit s’envisager sur le long terme. Les montants investis sur les supports en unités de compte supportent des risques de perte en capital. Ils ne sont pas garantis par l'assureur et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les objectifs de rendement sont non garantis.
Un contrat pensé pour la performance à long terme
La structure de Louve Infinity repose sur deux leviers essentiels :
- Des frais de gestion réduits, pour préserver la capitalisation dans le temps.
- Une sélection rigoureuse de supports financiers, composés de fonds indiciels et d’ETF à faibles frais internes, complétés par des fonds thématiques et immobiliers pour ceux qui souhaitent diversifier leur exposition.
Cette approche vise à combiner simplicité et efficacité : l’investisseur garde la liberté de gérer son allocation, tout en accédant à des supports solides et transparents.
Une transparence totale sur les coûts
Contrairement à certains contrats où les frais sont difficiles à identifier, Louve Infinity met l’accent sur la clarté et la simplicité de sa tarification.
L’ensemble des frais est connu à l’avance : aucun frais d’entrée, aucun frais d’arbitrage, et des frais de gestion clairement définis sur les supports en unités de compte.
Les frais prélevés sur le contrat sont partagés entre l’assureur et Louve Invest, qui perçoit une part de cette rémunération au titre de la distribution du contrat.
Aucun frais additionnel n’est facturé au-delà de ce cadre : le coût total reste transparent et limité, afin de préserver la performance nette de l’épargne.
Un accompagnement inclus, sans surcoût
Louve Infinity permet à chacun d’investir selon son profil et son niveau d’autonomie :
- en gestion libre, pour ceux qui souhaitent composer eux-mêmes leur portefeuille,
- ou avec un accompagnement personnalisé, pour ceux qui veulent être conseillés dans leurs choix d’allocation.
Dans tous les cas, le conseil est inclus, sans frais supplémentaires ni commissions additionnelles.
L’objectif est d’offrir un service clair, complet et équitable, quelle que soit la manière dont l’épargnant choisit d’investir.
Louve Infinity en résumé
En conclusion
Louve Infinity s’inscrit dans la nouvelle génération de contrats d’assurance-vie : transparents, digitaux et centrés sur la performance nette.Avec ses frais parmi les plus bas du marché, un accompagnement sans surcoût et une sélection rigoureuse de supports, il place la clarté et la rentabilité durable au cœur de la relation entre l’épargnant et son contrat.
Comparer les contrats d’assurance-vie ne consiste pas seulement à regarder le rendement du fonds en euros ou la performance passée d’un support.
Pour évaluer un contrat de manière pertinente, il faut analyser sa structure de frais dans le détail, comprendre leur effet dans le temps et s’assurer que les supports proposés justifient le niveau de coût global.
Étape 1 – Identifier et comprendre les frais réels du contrat
Le premier réflexe consiste à vérifier la nature et le montant de tous les frais susceptibles d’être prélevés tout au long de la vie du contrat.
Ces informations sont disponibles dans les documents d’information clés (DIC) fournis par l’assureur pour chaque support financier.
Ils détaillent les frais appliqués par l’assureur, le distributeur et la société de gestion.
Les principaux postes à examiner :
- Frais d’entrée ou de versement : souvent de 2 % à 5 % dans les réseaux traditionnels, 0 % sur Louve Infinity.
- Frais de gestion du contrat : généralement entre 0,3 % et 1 % selon le type de contrat, 0,35 % (0,39 % à terme) sur Louve Infinity.
- Frais internes des supports financiers (unités de compte) : varient de 0,05 % pour les ETF à plus de 2 % pour certains fonds actifs, selon le support choisi ; ces frais sont inclus dans la performance du support.
- Frais d’arbitrage : souvent forfaitaires (10 à 30 €) ou proportionnels (0,5 %) dans les contrats classiques, 0 € sur Louve Infinity.
- Frais sur options de gestion et de garantie : peuvent atteindre 0,3 % à 0,5 % par an lorsqu’elles sont activées, toutes optionnelles sur Louve Infinity.
Un DIC clair doit permettre de visualiser le coût total des frais sur la durée, ainsi que leur impact estimé sur la performance.
Comparer plusieurs DIC est le moyen le plus fiable d’identifier un contrat réellement transparent.
Étape 2 – Évaluer l’impact des frais dans la durée
Deux contrats affichant un rendement brut équivalent peuvent produire des résultats très différents après 15 ou 20 ans, uniquement à cause d’un écart de 0,1 % ou 0,2 % de frais annuels.
Cet effet cumulatif, souvent sous-estimé, a un impact direct sur la capitalisation.
Un exemple : sur un capital de 50 000 €, investi à 5 % brut sur 20 ans, la différence entre 0,35 % et 0,50 % de frais représente plus de 3 500 € d’écart de capital final.
Simuler ce type de scénario (à l’aide d’un tableur ou d’un simulateur en ligne) permet de mesurer concrètement l’effet du niveau de frais sur la performance nette.
Étape 3 – Vérifier la performance et la qualité des supports
Les frais ne font pas tout.
Un contrat à bas coûts reste peu attractif si les supports proposés — unités de compte ou fonds en euros — affichent des performances décevantes.
Il est donc essentiel d’analyser :
- la performance historique du fonds en euros, qui reste une base de stabilité ;
- la qualité des unités de compte : type de gestion (indicielle ou active), diversification sectorielle et géographique, cohérence avec votre profil de risque.
Un contrat performant combine des frais maîtrisés et des supports efficaces, adaptés à vos objectifs d’investissement.
En résumé
Comparer les frais d’assurance-vie, c’est évaluer la rentabilité nette à long terme plutôt qu’un seul taux affiché.
Le contrat idéal est celui qui associe :
- des frais bas et clairement identifiés,
- une structure transparente et sans frais cachés,
- des supports performants et bien sélectionnés, capables de créer de la valeur sur la durée.
C’est l’alliance entre frais maîtrisés et qualité des supports financiers qui fait, à long terme, la différence dans la performance réelle d’un contrat d’assurance-vie.
Même lorsque les frais principaux d’un contrat sont clairement indiqués, certains coûts moins visibles peuvent influencer la performance finale.
Ils ne sont pas illégitimes, mais souvent mal compris ou peu mis en avant dans les brochures commerciales.
Les connaître, c’est pouvoir mieux les anticiper.
Les frais internes des supports financiers
Chaque unité de compte (UC) correspond à un support d’investissement — ETF, OPCVM, fonds thématique, immobilier, SCPI… — géré par une société de gestion.
Ces supports intègrent leurs propres frais de gestion internes, prélevés directement sur la valeur liquidative du fonds :
- Pour un ETF, ces frais sont très faibles : souvent entre 0,05 % et 0,30 % par an.
- Pour un fonds actif, ils peuvent atteindre 1 % à 2 %.
- Pour certains supports spécialisés (fonds thématiques, private equity, immobilier non coté), ils peuvent dépasser 2 %.
Ces frais ne figurent pas sur votre contrat d’assurance-vie : ils sont déduits en amont, ce qui explique pourquoi deux supports au profil similaire peuvent afficher des performances nettes différentes.
Les frais de surperformance
Certains fonds actifs appliquent des frais de surperformance (performance fees), prélevés uniquement lorsque le gérant dépasse un objectif de référence (benchmark).
Par exemple : un fonds actions Europe peut facturer 15 % de la surperformance au-delà de l’indice Euro Stoxx 50.
Ces frais viennent s’ajouter aux frais de gestion classiques du fonds.
Ils ne concernent jamais les ETF, mais peuvent impacter significativement la performance des fonds actifs.
Il est donc essentiel de vérifier, dans le DIC du support, si ces frais de performance sont prévus et selon quelles conditions.
Les options de gestion automatiques activées par défaut
Certains contrats activent par défaut des options de gestion automatiques (rééquilibrage périodique, sécurisation des plus-values, investissement progressif…).
Chacune de ces options peut générer des frais additionnels (souvent 0,1 % à 0,3 % par an) ou des arbitrages automatiques déclenchant des coûts indirects.
Ces outils peuvent être utiles, mais ils ne conviennent pas à tous les profils.
Avant de souscrire, il est donc recommandé de vérifier si ces options sont :
- activées par défaut,
- vraiment nécessaires à votre stratégie patrimoniale.
Les frais liés aux supports immobiliers (SCPI, SCI, OPCI)
Les supports immobiliers intégrés dans certains contrats d’assurance-vie offrent une diversification intéressante, mais ils comportent leurs propres frais internes :
- frais de souscription (généralement 8 % à 10 % pour les SCPI),
- frais de gestion de la société de gestion (autour de 10 % à 12 % des loyers encaissés).
Ces frais ne sont pas prélevés par l’assureur, mais par la société de gestion immobilière.
Ils sont donc à prendre en compte dans le calcul de la performance nette de votre allocation globale.
À surveiller avant de souscrire
En résumé
Les frais “cachés” ne sont pas des frais dissimulés, mais des coûts complémentaires inhérents à la nature des supports choisis.Ils ne dépendent pas uniquement du contrat, mais aussi de la stratégie d’investissement de l’épargnant.Les identifier avant de souscrire, c’est s’assurer que la performance nette correspond vraiment à vos attentes et à votre profil d’investisseur.
Réduire les frais de son assurance-vie, c’est améliorer directement la performance nette de son épargne.
Chaque dixième de point économisé sur les frais de gestion peut représenter plusieurs milliers d’euros de gain à long terme.
Mais pour y parvenir, il faut distinguer les leviers structurels liés au contrat, et ceux qui dépendent directement de l’investisseur.
Choisir un contrat à faibles frais structurels
C’est le premier levier, et sans doute le plus important.
Les contrats distribués en ligne ou par des plateformes digitales affichent 0 % de frais d’entrée et des frais de gestion compris entre 0,3 % et 0,5 %, contre souvent 0,8 % à 1 % dans les contrats bancaires traditionnels.
Un contrat à faibles frais structurels permet de maximiser la part réellement investie et d’éviter les ponctions récurrentes.
Avant toute souscription, comparez toujours les frais de gestion du contrat, les frais internes moyens des supports proposés, et la présence éventuelle d’arbitrages payants.
Privilégier les supports à faibles coûts internes
Le choix des unités de compte (UC) a un impact déterminant sur la performance finale.
Les ETF et fonds indiciels sont aujourd’hui les supports les plus efficaces pour réduire les coûts internes, avec des frais souvent compris entre 0,05 % et 0,30 % par an.
Ils répliquent simplement un indice (CAC 40, MSCI World, Nasdaq, etc.), sans frais de gestion active.
À l’inverse, les fonds actifs, thématiques ou spécialisés peuvent afficher des frais internes bien plus élevés — jusqu’à 2 % par an, voire davantage —, sans garantie de surperformance.
Il est donc préférable de diversifier entre plusieurs classes d’actifs tout en privilégiant les supports les plus efficients en termes de rapport coût/performance.
Limiter les arbitrages et options automatiques inutiles
Les arbitrages fréquents — c’est-à-dire les transferts de capital entre différents supports — peuvent générer des frais récurrents ou déclencher des coûts indirects s’ils activent des options de gestion automatiques.
Chaque opération, même gratuite sur le papier, peut engendrer des écarts de valorisation ou des délais de réinvestissement pénalisants.
Avant de souscrire, vérifiez si certaines options de gestion automatiques sont activées par défaut :
- rééquilibrage périodique,
- sécurisation des plus-values,
- investissement progressif.
Ces services peuvent être utiles, mais ils ne sont pas indispensables à tous les profils d’investisseurs.
Mieux vaut les activer en connaissance de cause, en fonction de sa stratégie réelle.
Vérifier la cohérence entre frais et accompagnement
Tous les contrats ne proposent pas le même niveau de service.
Certains offrent un accompagnement patrimonial ou une gestion pilotée : des services à valeur ajoutée, mais qui se répercutent dans les frais.
L’essentiel est de vérifier que le coût du service correspond à la valeur apportée.
Un contrat à bas frais sans accompagnement personnalisé peut convenir à un investisseur autonome, alors qu’un contrat légèrement plus cher peut rester compétitif s’il offre un suivi efficace et transparent.Le bon choix est celui qui s’aligne sur vos besoins réels.
Face à la montée des nouveaux contrats à faibles coûts, beaucoup d’épargnants se demandent s’il est pertinent de changer de contrat d’assurance-vie pour bénéficier de frais plus compétitifs.
Mais avant de franchir le pas, il faut évaluer plusieurs paramètres : les gains espérés, les frais liés à la sortie, la garantie du contrat et surtout l’impact fiscal d’une telle décision.
Comparer objectivement les frais et les services
La première étape consiste à analyser la structure de votre contrat actuel :
- Frais d’entrée : de 2 % à 5 % sur les anciens contrats.
- Frais de gestion : souvent autour de 0,9 % à 1 % sur les unités de compte, et 0,6 % à 0,8 % sur le fonds en euros.
- Frais d’arbitrage ou d’options automatiques : parfois facturés à chaque opération.
Comparez ces montants avec ceux des nouveaux contrats digitaux, où les frais de gestion se situent entre 0,3 % et 0,5 %, et où les frais d’entrée ou d’arbitrage sont souvent nuls.
Si l’écart dépasse 0,4 à 0,5 point, il peut être rentable d’envisager une nouvelle souscription.
Mais attention : il faut aussi tenir compte des services proposés, de la qualité des supports disponibles, et de la solidité de l’assureur.
Un contrat moins cher n’est pas forcément meilleur s’il offre un univers d’investissement plus restreint ou un service client moins réactif.
Les précautions fiscales à connaître
Avant toute fermeture de contrat, il est essentiel d’évaluer les conséquences fiscales.
La date d’ouverture détermine l’ancienneté fiscale, et donc les avantages liés à la durée de détention (notamment après 8 ans).
- Fermer un contrat ancien et en ouvrir un nouveau fait perdre l’antériorité fiscale.
- Les produits générés sont alors soumis à l’impôt sur le revenu ou au PFU (30 %), sauf exonération spécifique.
Pour éviter cela, il est souvent préférable de conserver son contrat actuel et d’ouvrir un nouveau contrat plus compétitif pour ses futurs versements.
Cette stratégie permet de bénéficier de conditions de frais plus attractives sans sacrifier les avantages fiscaux accumulés.
Transfert, rachat ou nouvelle souscription ?
Contrairement à d’autres produits d’épargne (PER, PEA, etc.), les contrats d’assurance-vie ne sont pas transférables d’un assureur à un autre.
Il n’existe donc aucun transfert direct permettant de changer de contrat tout en conservant son antériorité fiscale.
Les alternatives possibles sont :
- Rachat total : clôture du contrat et ouverture d’un nouveau (perte d’ancienneté fiscale).
- Rachat partiel : retrait d’une partie de l’épargne pour la réinvestir ailleurs.
- Ouverture complémentaire : un nouveau contrat, souvent en ligne, avec des frais réduits.
Dans la plupart des cas, la coexistence de deux contrats est la solution la plus efficace : vous conservez les avantages fiscaux de l’ancien, tout en profitant de la compétitivité du nouveau.
Le rôle de la FGAP : un point souvent oublié
Changer de contrat signifie souvent changer d’assureur.
Or, chaque contrat d’assurance-vie est couvert par le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP), qui protège les assurés en cas de défaillance de l’assureur.
Cette garantie couvre jusqu’à 70 000 € par assuré et par compagnie d’assurance, tous contrats confondus.
Ainsi, détenir plusieurs contrats auprès d’assureurs différents peut être un moyen de diversifier non seulement ses supports financiers, mais aussi ses risques de contrepartie.
La FGAP ne garantit pas la performance, ni le capital en cas de baisse des marchés, mais elle constitue une protection supplémentaire en cas de faillite de l’assureur.
Un élément à prendre en compte avant de regrouper tout son patrimoine d’assurance-vie chez un seul acteur.
Quand le changement d’assurance-vie est-il pertinent ?
Changer ou compléter son contrat peut être judicieux si :
- votre contrat actuel date de plus de 10 ans et affiche des frais supérieurs à 0,8 %,
- les supports disponibles sont limités (absence d’ETF, peu de diversification),
- ou si les frais de gestion absorbent une part importante du rendement potentiel.
Dans ces cas, ouvrir un contrat à frais réduits pour les nouveaux versements est souvent la meilleure option.
Cette approche progressive permet de moderniser sa stratégie d’épargne sans perte fiscale et avec une meilleure répartition du risque assureur.
Ce qu’il faut retenir avant de changer de contrat
Changer de contrat d’assurance-vie n’est pas une décision anodine.
Avant toute action, il est recommandé de :
- Comparer objectivement les frais, la qualité des supports et la solidité de l’assureur.
- Mesurer les implications fiscales liées à un rachat total ou partiel.
- Diversifier ses contrats plutôt que de tout regrouper sur un seul.
Le but n’est pas seulement de réduire les frais, mais de renforcer la résilience et la rentabilité globale de son épargne.Un contrat bien choisi aujourd’hui doit être capable de durer, même si le marché et les acteurs continuent d’évoluer.
Après plusieurs années de baisse progressive des coûts, les contrats d’assurance-vie entrent dans une ère de normalisation.
Les épargnants comparent davantage, la réglementation pousse à la transparence, et les acteurs digitaux ont profondément transformé les standards du marché.
Mais jusqu’où peut descendre le niveau des frais ? Et quel est aujourd’hui le juste prix d’un contrat compétitif et durable ?
Des frais historiquement élevés, en repli constant
Pendant longtemps, les contrats d’assurance-vie affichaient des frais d’entrée de 3 à 5 % et des frais de gestion proches de 1 % sur les unités de compte.
Ces niveaux, hérités d’un modèle de distribution très intermédié, ont progressivement reculé avec la montée des plateformes en ligne et la pression concurrentielle.
En 2025, la majorité des nouveaux contrats digitaux se situent entre :
- 0 % de frais d’entrée,
- 0,39 % à 0,50 % de frais de gestion sur les unités de compte,
- et 0 € de frais d’arbitrage.
Cette tendance vers plus de simplicité et de clarté profite directement aux épargnants, qui conservent une part plus importante de la performance générée.
Le juste équilibre entre coûts et services
Un contrat d’assurance-vie n’est pas qu’une question de frais.
Réduire les coûts à l’extrême n’a de sens que si la qualité des supports financiers, la solidité de l’assureur et la transparence du modèle restent au rendez-vous.
Le bon contrat est celui qui trouve le juste équilibre entre :
- des frais de gestion raisonnables (autour de 0,39 % à 0,5 % sur UC),
- une offre de supports diversifiée et performante,
- une infrastructure digitale fiable,
- et un service client accessible et compétent.
Chercher le contrat le moins cher à tout prix revient souvent à ignorer la valeur ajoutée du suivi, de la pédagogie et de la qualité d’exécution — des éléments essentiels sur un horizon de long terme.
Tableau de synthèse : les standards du marché en 2025
Ce tableau illustre la convergence du marché vers un niveau moyen de 0,39 % à 0,5 % sur UC, considéré comme la norme de compétitivité en 2025.
Sous ce seuil, les marges de baisse deviennent limitées sans compromis sur la qualité de gestion.
La transparence, nouveau critère de confiance
Au-delà des pourcentages, la lisibilité des frais est devenue un critère central dans le choix d’un contrat.
Les épargnants recherchent désormais des offres où chaque coût est identifié, justifié et compréhensible.
Cette exigence de transparence bénéficie à tout le marché :
- elle favorise les acteurs les plus clairs,
- elle renforce la confiance dans la relation assureur-épargnant,
- et elle incite à des modèles économiques plus équilibrés.
À terme, cette évolution devrait conduire à une stabilisation des frais autour d’un “juste prix”, garantissant à la fois la rentabilité du contrat pour l’épargnant et la pérennité du modèle pour les distributeurs.
Le mot de la fin sur les frais d’assurance-vie
Le “juste prix” des frais d’assurance-vie n’est pas celui du contrat le moins cher, mais celui qui offre la meilleure performance nette sur la durée.
Un bon contrat combine :
- frais maîtrisés,
- supports performants et transparents,
- un cadre solide (assureur fiable, garantie FGAP, distribution claire).
Dans un environnement où chaque dixième de point compte, la différence ne se joue plus seulement sur le coût, mais sur la qualité de l’allocation et de la gestion à long terme.C’est cette approche équilibrée — entre performance, sécurité et transparence — qui définit aujourd’hui le véritable “juste prix” de l’assurance-vie.